L’histoire de Cheyssieu
Cheyssieu
Commune de 566 habitants en 1982 (423 en 1975, 355 en 1866. Superficie: 855 hectares. Altitude: 220 mètres. Origine du nom : Cassius (domaine de). Les habitants de Cheyssieu sont appelés les Cheyssinois ou Cheyssiers.
Cheyssieu, au nord de la Varèze, près du lieu où la rivière reçoit les eaux du Bozon et du Suzon, est d’origine très ancienne. Le village tire son nom de l’époque gallo-romaine. Après la conquête, selon Chorier, chaque territoire reçut le nom de celui qui y fut laissé pour en être le chef et qui était le plus considéré par sa naissance, son mérite ou ses richesses.
C’est ainsi que Roscille donna son nom à Roscillon, Surius à Surieu, comme Clavonaos donna le sien à la villa Clavonaco (Clonas) et Accius (ou Assius) à Assieu. De la même manière, Cheyssieu était le territoire de Cassius.
Cheyssieu, de la gaule romaine à la féodalité
Nous savons qu’à l’époque gallo-romaine, toute notre région eut une vie très active. Dans les campagnes, les Gaulois, subissant la domination de leurs vainqueurs, continuèrent à vivre en accord avec eux, à condition de payer les redevances réclamées, « arrosant de sueurs un sol où parfois des misérables tombaient, épuisés de fatigues et de faim » (selon Truffey, revue L’Allobroge, 1840).
Un souvenir de cette époque à Cheyssieu était un sarcophage de calcaire blanc qui se trouvait, selon Allmer, « dans la cour de la maison Josserand, où il servait d’auge à côté d’un puits ». Acquis en 1971 par la ville de Vienne, il est exposé aujourd’hui au musée lapidaire de cette ville. Il portait une épitaphe de Sex. Sollius Demosthenianus, offerte par sa fille, sa femme et son co-affranchi.
Après les invasions qui avaient provoqué sa ruine, l’Eglise de Vienne récupéra peu à peu les biens qu’elle avait acquis pendant la période de la paix romaine et à l’époque mérovingienne. Elle récupéra notamment les trois églises de Saint-Alban, Saint-Prim et Saint-Martin, des Côtes d’Arey, avec les terres et serfs en dépendant.
C’est à cette époque que les moines réorganisèrent les paroisses, aux IXe et Xe siècles. Ainsi, les paroisses du nord du canton, placées sous la domination des seigneurs de Roussillon, furent d’abord desservies par les clercs de Saint-Pierre et de Saint-Maurice-de-Vienne qui, jusqu’à la Révolution, avaient conservé le privilège d’en nommer les curés.
Nous savons qu’Auberives, avant d’être paroisse indépendante, fut d’abord une succursale de Cheyssieu, qui était un mandement important. Le mandement de Cheyssieu s’étendait notamment à Vernioz et Vitrieu.
Cheyssieu sous la féodalité
Les spécialistes des mottes féodales en ont inventorié une à Cheyssieu, dite La Pouape ou La Poype. Le lieu dit n’existe plus aujourd’hui sur les plans locaux. Mais, dans les registres paroissiaux, on trouve la mention du décès, le mercredy neuvième août 1702, de Jean Valiüs, soutier au domaine de la Poepe, appartenant au sieur de Gouvernet.
Ce domaine était probablement celui de la motte, située au quartier de Beauchuzel, dominant la Varèze au-dessus de l’auberge des Etangs, près de Fonfroide. De petits seigneurs aux XIe et XIIe siècles, période des mottes féodales, y ont certainement régné. Aujourd’hui, on peut y voir les vestiges du château de Boxuselle, dont on trouve l’indication sur la carte de Cassini, avec celle de plusieurs châteaux ou maisons fortes : Grange Neuve, Bachou, Orillère.
Mais le territoire de Cheyssieu dépendait des puissants seigneurs voisins et d’abord des sires de Roussillon. Nous savons qu’au XIVe siècle, Auberives est une possession des Romestaing, seigneur de Vaugris, et qu’ensuite la seigneurie passe à la famille d’Illins qui domine également Chonas et Les Côtes-d’Arey. Cheyssieu, mandement dont dépendait Auberives, en raison de sa situation, n’échappe pas à cette domination.
Ainsi, Cheyssieu, qui avait une importance certaine au nord du canton, comme paroisse et comme mandement, a dû jouer un grand rôle dans le passé. L’on peut affirmer que le territoire de Cheyssieu, qui dépendait de l’Eglise de Vienne, des seigneurs de Roussillon, d’Illins et des Côtes d’Arey, a eu un sort étroitement lié à celui des paroisses voisines, notamment Les Côtes-d’Arey, Vernioz, Assieu et Auberives.
La carte de Cassini de 1760 indique un hôpital à Cheyssieu. A la fin du XVIIe siècle, vers 1696, les biens des maladreries et hôpitaux de village, qui avaient cessé de fonctionner avaient été affectés à l’Hôtel Dieu de Vienne. Il faut croire qu’en 1760, l’hôpital de Cheyssieu était encore indépendant et continuait à fonctionner.

L’église. (Archives Horvath – CL. G. Gardes)
La vie des paysans avant 1789
Notre histoire de France, si elle nous apprend les faits et les grands événements, nous apprend aussi ce que fut la vie très dure des paysans dans le passé. Elle fut dure également dans tout le territoire de notre canton. Selon Louis Dugas, les paysans subirent non seulement les effets des guerres et des invasions, non seulement ceux des contributions et des tailles, mais parfois ceux de la famine. Il en était encore ainsi au XVIe siècle.
Ainsi, en 1585, à l’époque de la Ligue, nous rappelle Louis Dugas, ce fut une affreuse disette. « C’était chose ordinaire de vivre de la gland, manger racines et herbes sauvages, faire pain de fougère et manger pépins séchés au four et passés au moulin ».
La famine fut terrible sur les deux rives du Rhône. Les moissons de 1585 ne produisirent que la semence pour l’année suivante et l’hiver fut mortel. Le blé devint hors de prix. Tout près de nous, à Condrieu, il mourut en trois mois, mille deux cents personnes en 1586, la guerre ajoutant ses morts à ceux de la famine et de la peste. Et la fin de la guerre, avec Henri IV, après les excès de la Ligue, fut un événement considérable, mettant fin pour un temps à la grande misère des campagnes. Louis Dugas transcrit le refrain de l’époque qui était chanté certainement dans tout notre canton :
« Vive Henry Quatre
Vive ce roi vaillant !
Ce diable à quatre
Eut le triple talent
De boire et de battre
Et d’être un vert-galant ! »
Si ce refrain fut le symbole d’un répit, d’autres périodes suivirent, hélas, avec de nouvelles misères et de nouvelles famines, dont l’accumulation aboutit à des révoltes qui purent se donner libre cours avec la Révolution.
Les moulins de la Varèze
De nombreux moulins, échelonnés sur tout le cours de la rivière, ont marqué l’histoire du Moyen Age. Le moulin de Cheyssieu existait déjà à l’époque mérovingienne, vers l’an 700, peut-être avant. Sous la féodalité, il appartenait, par la baronnie d’Auberives, à la famille de Roussillon. Le moulin fut successivement la propriété des divers seigneurs d’Auberive et il resta jusqu’à la Révolution, aux descendants du marquis de Gouvernet. Les meuniers payaient au seigneur le droit de banalité qu’ils percevaient sur les paysans.
Au début de la Révolution, le citoyen Jacques Josserand achète le moulin, dont il était fermier depuis le 21 janvier 1750. La famille Josserand-Baudrant le possède jusqu’en 1920 ; date à laquelle les héritiers le vendent à Jean-Joseph Genthon, meunier depuis 1910, dont la famille exploite désormais le moulin, de père en fils, jusqu’à aujourd’hui.
Les moulins de la Varèze, celui de la Trappe, à Vernioz comme ceux d’Auberives et de Clonas, ont cessé toute activité au cours des XIXe et XXe siècles, celui de Cheyssieu est le seul qui fonctionne encore. Depuis 1928, il a su s’adapter avec des équipements nouveaux. Il est devenu de nos jours une entreprise importance de minoterie, fabriquant la farine panifiable et les aliments du bétail, selon des méthodes scientifiques modernes.
Mais il garde le souvenir du passé, avec sa grande roue à aubes, son vieux plancher conservé dans la partie ancienne du bâtiment actuel et les vieilles meules, articles de musée.
Autrefois, les paysans de Cheyssieu venaient en charrette, y faire moudre leur blé. Ceux des Côtes-d’Arey allaient au moulin de Vernioz. Selon Jean-François Grenouiller, les chemins étaient en mauvais état et le trajet fort difficile en hiver.
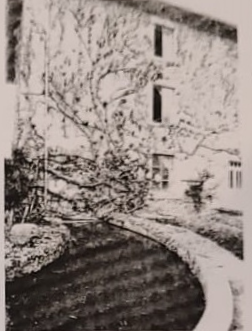
Le bief du vieux moulin de Cheyssieu
Cheyssieu aujourd’hui
Comme les communes rurales voisines, Cheyssieu a une vie essentiellement agricole. Une partie de la population est constituée d’artisans et d’ouvriers.
Les cultures traditionnelles et l’élevage sont complétées par les cultures fruitières. Certains noms de quartiers rappellent les anciennes activités agricoles : Champ Granges, les Vignasses, les Noyarets, les Meuilles, le Vivier etc.
En dehors des moulins, de petits établissements industriels vivent de l’environnement agricole.
Le tourisme et les loisirs de plein air trouvent un cadre naturel, aux bords de la Varèze, avec le camping-caravaning.

Carte postale ancienne de Cheyssieu






